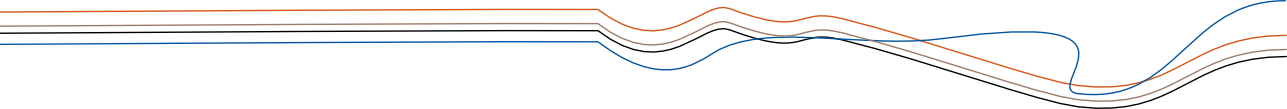J’ai mis longtemps à écrire cette chronique. A chaque fois je me disais Il faut acter, et justement, je ne parvenais pas à acter la fin d’une période, celle de mon nomadisme en fourgon. Ce fourgon si joyeusement nommé Mon Chéri.
Les faits sont pourtant simples à décrire : J’ai acheté une maison.
J’ai acheté une maison alors que je pensais mon petit pécule insuffisant pour une telle démarche. J’ai acheté une maison alors que je pensais vadrouiller encore une année en fourgon, j’ai acheté une maison à retaper alors que je ne sais pratiquement pas bricoler, j’ai acheté une maison qui semblait m’attendre et c’est une bouleversante expérience.
Faux-la-Montagne est mon nouveau chez moi après un coup de foudre pour cette commune de moins de 500 habitant.es et pourtant si dynamique : commerces, école primaire, bibliothèque, espace de coworking, radio et télévision locales, cabinet médical, festivals, etc. Village sis sur le plateau de Millevaches, montagne limousine, plateau granitique que se partage la Corrèze, la Haute-Vienne et la Creuse. Territoire où je me suis sentie chez moi avec l’envie de m’y poser, de m’y arrêter et une maison a rendu cela possible.
J’ai acheté une de ces maisons de village peu attrayantes car sans terrain, même si ma courette est une merveille où je pourrai profiter du soleil, semer quelques plantes aromatiques et inviter les ami.es à prendre l’apéro.
Je me suis installée un 31 décembre pour que la nouvelle année débute précisément par ce vivre dans une maison en dur comme le veux l’expression. Pourtant il n’y a rien d’évident à s’installer dans une vieille maison, en plein hiver, alors que le bûcher est vide de bois, que les robinets fuient et que l’on ne sait pas comment fonctionne le chauffe-eau ou la cuisinière à bois et qu’allumer un feu convenablement a pris du temps. Heureusement des meubles laissés sur place ont rendu l’installation moins difficile car hormis le contenu du fourgon et quelques cartons (essentiellement des livres) stockés chez l’une de mes filles, je n’avais rien. Pas de lits, pas de de tables, pas d’outils, pas même une scie ou une hache pour couper du bois. Heureusement j’ai profité d’une belle solidarité de la part du voisinage et de ma famille, et aussi d’une liste de diffusion locale qui fonctionne bien (on y troque des infos, du matos, des bons plans).
Quant au froid, j’ai pris l’habitude depuis quelques années de partager mon lit avec une bouillotte. Rien de romantique mais très efficace contre les pieds gelés.
Bien sûr il y a eu (et il y aura) des moments de doutes devant l’ampleur des travaux et la modestie de mes moyens financiers, sans parler de mes incompétences, mais quand le moral est bas j’entreprends un tour du lac, soit une bonne bonne heure de marche. Une excellente manière de désamorcer les pensées négatives et, bientôt, je vais pouvoir y nager et bientôt, je pense intégrer le groupe qui se baigne chaque lundi quel que soit le temps et la température. Après ce temps de marche, je regarde ma baraque d’un autre œil et me rassure par ces mots : En fait, je me suis offert un lac !
Ici comme dans le fourgon ou la Caboulotte mon questionnement aura été : Est-ce que je vais réussir à écrire ? Force est de constater que l’écriture se fait dans la nouvelle maison.
Et je ne vis pas en dehors du monde même si ici on est loin des transports en commun. Au contraire, le monde d’ici est bien réel même s’il ne fait pas souvent la une des médias sauf quand il y a soulèvement de sa part.
J’écris chaque jour et reste fortement engagée comme citoyenne et défenseuse (ça sonne un peu comme défonceuse !) d’un monde plus égalitaire.
D’ailleurs la signature de la tribune contre le parrainage du Printemps des poètes par Sylvain Tesson m’aura bien vite remise en action. L’expérience m’aura permis d’évaluer la puissance et la violence du droite extrême et réac, et aussi de constater la douloureuse absence de soutien de personnes pour lesquels j’avais non pas de l’admiration mais une certaine attente. Décevant l’art de ne pas y toucher de l’écrivain Nicolas Mathieu qui navigue maintenant dans des sphères sociales autrement plus confortables que celle des cancrelats de gauche, des wokistes et des poètes que personne ne lit (sic), décevants les commentaires du traducteur et éditorialiste André Markowicz qui nous aura traités de pleutres (prouvant ainsi, comme beaucoup, qu’il ne connaissait rien à la réalité de ceux et celles qui œuvrent au quotidien pour la poésie et avec la poésie, ignorant que nous avions bien plus à perdre que celui qu’on nomme le Prince de la poésie). Bien que maladroite cette tribune aura permis le dévoilement d’un monde littéraire et journalistique dominant et méprisant pour les Travailleurs et Travailleuses du texte que nous sommes (j’adore ce terme !). Et in fine le dysfonctionnement d’une association qui œuvrait surtout pour la communication d’elle-même et le bien-être de sa directrice.
Il y aura de quoi m’énerver encore dans mes écrits que je vive en appartement, en cabane, en fourgon ou en maison !
Donc j’habite maintenant dans une baraque au fin fond de la Creuse du sud. Mon Chéri est retourné dans l’atelier de Van Road Evasion, Xavier et son équipe vont lui refaire une beauté et il sera vendu au printemps. Cela me vrille le ventre et le cœur mais j’ai fait un choix. Ce choix m’étonne parfois mais il est un fait.
Je ne sais pas si cette nouvelle façon de vivre donnera lieu à des chroniques, sûrement, car c’est une routine que j’aime bien. Et surtout, le singulier village où je vis maintenant, mérite qu’on s’y arrête et j’ai déjà quelques portraits en perspective. Il y a ici des personnes très engagées sur le plan de l’écologie, de la solidarité citoyenne et aussi de la débrouille.
Ainsi je pense à cette jeune femme graphiste contrainte d’accepter des petits boulots de survie qui m’a avoué lors d’une discussion : « Jusqu’à présent je vivais modestement, je me débrouillais pas mal car on peut vivre avec peu ici. Mais depuis quelques mois, j’ai descendu une marche. Une marche terrible car maintenant je suis précaire. Il n’y a plus de marches à descendre. Plus bas, c’est l’abîme. »
Une parole percutante car si je reste désespérément optimiste, je suis très consciente que les classes moyennes et ouvrières se fragilisent. Consciente de la puissance d’un droite extrême aux manettes de nombreux médias et des grandes entreprises, que cette droite n’est pas celle du RN mais qu’elle vient s’y ajouter. Il se fabrique un monde qui a peur, et cette peur-là est un formidable levier pour ceux et celles qui veulent le suprême pouvoir.
Alors disons qu’ici en Creuse, dans ce petit village, je reprends courage et je me sens moins seule. J’ai le sentiment d’habiter dans un lieu qui est déjà (en partie) entré en résistance. Je n’ai plus peur.
-
Mon Chéri 29 – Fin de la saison 1

-
Eve

Lors d’une soirée lecture et dégustation à la Maison Robert Schuman, je l’ai entendue évoquer les vins qu’elle produit et les particularités de son domaine Les Béliers avec des mots qui résonnaient fortement avec ma propre expérience.
D’abord son départ, jeune fille, d’une région dont le climat parfois rigoureux et une certaine absence de lumière l’hiver l’ont poussée vers d’autres contrées. Aller voir ailleurs. Apprendre d’autres métiers dont celui qui l’occupe aujourd’hui, la viticulture.
Puis l’envie de revenir dans l’Est et prendre en main l’exploitation familiale qui jusqu’alors était une activité annexe, le travail c’était d’abord l’usine. Coteaux de Moselle, label bio, cépages de première époque qui se plaisent sur les sols calcaires du Jurassique, vendanges à la main … Eve est enjouée quand elle parle de sa production, travail soigné et volonté de faire exister aussi le territoire en proposant un accueil en chambres d’hôtes et cabanes dans les arbres.
Elle ne cache pas non plus l’engagement nécessaire et parfois la fatigue car il faut tenir la cadence avec chaque année son lot de difficultés : trop d’eau, pas assez d’eau, trop de soleil, pas assez de soleil et, en tout cas, la constance du travail à fournir.
J’ai passé une nuit dans l’une des chambres d’hôte dont la baie vitrée occupait tout un pan de mur, s’ouvrant sur le domaine et les bois avoisinants. C’était l’automne. Soleil et feuillages flamboyants, fraicheur de l’air puis le retour des brumes.
Pinot noir, Auxerrois et rosé pétillant. Mes cadeaux de Noël auront un air de Moselle. -
Mon Chéri on the parking -28

Ma résidence d’écriture à Scy-Chazelles prend fin – un peu le blues … sous la neige. Deux mois à dormir en gîte et à profiter du confort d’une maison et redécouvrir ma formidable capacité à m’étaler de partout. Toutes les tables recouvertes par les carnets, les livres, l’ordinateur, l’appareil photo, les feutres, les crayons, la boite à aquarelles, les pinceaux, les chargeurs, le galet en lapis-lazuli, les ramettes de papier, les dossiers, le disque dur, les revues, la mascotte vintage, les journaux papiers et des bouquins et des bouquins et des bouquins. J’ai même demandé une table supplémentaire.
Jeudi soir, je donnerai avec mon amie comédienne Anne de Boissy une lecture dite de clôture, à la libraire Autour du monde de Metz. Et il faudra tout rapatrier dans le fourgon qui aura peu servi ses deux derniers mois. Quelques trajets obligés et un seul week-end vers le lac de Madine et chaque fois que je prends le volant, je lui parle comme à un ami délaissé.
La résidence prend fin et beaucoup d’interrogations quant à la suite de ma vie nomade. J’aime l’inattendu et il y en a eu beaucoup ces derniers mois. Je reviendrais sur tout cela dans une prochaine chronique. Pour l’instant il neige sur mon fourgon, il neige sur la Moselle et dans d’autres pays se sont des grenades et des bombes qui tombent. C’est osé comme parallèle, voire indécent mais mon cerveau fonctionne ainsi. Il s’étale de partout.
Et tellement troublée que face à l’horreur des massacres, on veuille de moi une position univoque : tenir pour l’un ou pour l’autre camp quand souvent j’ai eu envie de dire : Mais merde, c’est une guerre pas un match de foot !
Face à toute cette violence, la seule phrase qui me fait du bien est celle prononcée par le peintre Ricardo Cavallo dans le documentaire qui lui est consacré : Souviens-toi de vivre ! Et cherchant à savoir si cette phrase était de lui, je découvre que c’est aussi le titre d’un poème du poète ukrainien Ivan Franko, un démocrate révolutionnaire mort en 1916 : Memori vivere.
La poésie ne sauvera pas le monde mais parfois, elle nous lave des pensées trop sombres. Et malgré, malgré, malgré … je peux dire que je viens bien et Mon Chéri aussi. -
Shirley

Je lui propose de la photographier devant sa collection de vieilles passoires, elle me dit : Je te vois venir, tu voudrais que j’en mette une sur la tête ! Elle accepte de poser mais n’aime pas ça. Je la connais depuis longtemps celle que l’on surnomme la Shirl parce que c’était pas courant un nom étranger dans les années 70. Je l’ai connue tenant une baraque à sandwichs et frites vers la piscine et son désespoir à cause de l’odeur d’huile chaude que même les douches ne parvenaient pas à effacer – je l’ai connue serveuse dans le café de sa mère, je l’ai connue s’éloignant de sa ville pour une vie plus tumultueuse en Belgique. Je l’ai vue gifler de toutes ses forces un type qui lui avait mis une main au cul. Depuis quelques années, elle travaille au service espace vert de la commune et se forge une solide réputation à poser des décorations faites d’objets récupérés, à bricoler des boites à livres de toutes les couleurs, à teindre des chaussures en rose, à s’investir auprès des enfants. Depuis peu elle met en valeur les objets qu’elle trouve dans les buissons des parcs quand vient la saison des tailles. Et c’est fou oui ce qu’elle y trouve. Tout n’a pas été facile pour elle, loin de là, mais elle n’aimerait pas que j’étale ici sa vie. On peut compter sur elle mais faut pas l’emmerder, la Shirl ! Je la connais bien car c’est ma nièce. On reste parfois plusieurs années sans se voir, mais il suffit de quelques heures ensemble pour qu’on se marre comme des nouilles. On retrouve la complicité de l’époque où, adolescente, je passais du temps avec elle et sa sœur, les dimanches d’ennui et on partait ensemble dans les bois ramasser des feuilles, de la mousse, des fleurs pour composer ensuite des trucs et des machins qu’on trouvait beau. Oui on partage cela le goût des autres, des trucs et des machins.
-
Mon Chéri on the road – 27

Étrange automne où l’on profite de la douceur et du soleil tout en sachant que le changement climatique perturbe dangereusement notre équilibre écologique. Les arbres souffrent, la terre souffre, les animaux migrateurs souffrent, les mal-logé.es souffrent, les pays pauvres souffrent et en France, on boit des spritz en terrasse. Les robes d’été virevoltent, les pantacourts sont encore de mise. On cherche de l’ombre pour échapper aux rayons du soleil.
Une absence d’inquiétude qui inquiète.
Vivre dehors et laisser au placard les blousons et les pulls. Certes la chaleur actuelle facilite ma vie en fourgon mais un cerisier qui fleurit en octobre, est un arbre qui s’épuise, se fragilise malgré la beauté de ses fleurs.
Dans les rues piétonnes de Dijon, j’ai entendu quelqu’un rétorquer à son amie qui soulignait l’étrangeté du climat : Viens pas me pourrir la vie avec ton écologie.
La vérité pourrit la vie, c’est dit.
Aujourd’hui j’écris, fenêtres grandes ouvertes, alors que le département de la Moselle est réputé pour la rigueur de son climat.
La bouillotte, la couette et les chaussettes en laine restent rangées au fond du coffre. Il y a peu je me baignais dans l’eau presque tiède du Loir ou cherchais vainement des champignons dans le Forêt de Bois-d’Arcy à l’humus trop sec malgré des jours de pluie.
Et à Scy-Chazelles où je viens d’arriver pour deux mois, la douceur du temps est un étonnement.
La photo qui illustre cette chronique a été prise par le photographe Anthony Picoré, chargé de couvrir la soirée de lancement de ma résidence d’écriture. Soirée organisée au musée de Gravelotte dédié à la guerre franco-allemande de 1870 et ses conséquences, notamment l’annexion de l’Alsace et de la Moselle.
Je connaissais Gravelotte pour l’avoir rejoint en vélo, dans les années 70, avec mon plus jeune frère, lui sur un demi course, moi sur un mini-vélo. A l’époque, enfourcher un vélo dit de garçon, ne se faisait pas pour une fille et tant pis pour le double effort ! Je nous vois encore pédaler comme des dératés puis visiter l’ancien musée (certainement le premier musée que je visitais de ma vie. J’avais 12 ans) aménagé dans une maison du village. Un musée un peu désuet mais connu pour la mise en scène d’une bataille sur une immense carte en relief et une flopée de soldats de plomb. La réalité virtuelle était de la science-fiction.
Des dizaines d’années plus tard, me voilà l’invitée du musée qui a migré dans un superbe bâtiment (on peu voir ici). Avec moi, à Gravelotte, ceux et celles qui organisent, financent, communiquent et facilitent ma résidence.
Mon fourgon a aussi eu droit aux honneurs du lieu puisque j’ai pu le garer derrière la verrière du musée, bien visible des invité.es (d’où l’idée d’en photographier l’intérieur). Mon chez moi aura été un lieu public un court moment.
D’être là, en Moselle, pour dresser une cartographie des souvenirs comme l’indique l’intitulé du programme de cette résidence, me ravit, m’émeut. Mosellane je suis et ce territoire traverse plusieurs de mes écrits, même si pendant longtemps j’ai rejeté cette appartenance, jusqu’à gommer l’accent de mon parler.
Après un temps de lecture, puis de musique, je me suis mise légèrement en retrait du buffet, des gens et de la conversation. Une envie de regarder la scène de loin, comme dans un film.
Et j’ai alors entendu la petite fille, encore tout en nage d’avoir tant pédalé, chuchoter à l’oreille de la dame que je suis devenue : On s’en sort pas mal pour des filles d’ouvrier, non ?
Oui, on s’en sort pas mal. -
Marion

Je rentre dans le jardin où elle œuvre sécateur à la main. Son sourire franc est un généreux accueil. Le bonnet de laine la quitte rarement, du moins quand je la croise. A ses pieds une paire de bottes en caoutchouc qu’elle a découpées à ras de la cheville pour faciliter le déchaussage. Des bottes achetées pas chers à Emmaüs car elle a l’art de la débrouille. Son sourire est le paravent pudique d’une vie où elle a dû se battre, s’adapter sans perdre sa liberté d’agir. Sa liberté d’être. De multiples boulots jalonnent sa vie, de l’étal des marchés aux jardins des particuliers. Depuis peu un nouveau job qui rend son sourire encore plus lumineux. Elle est employée par une toute récente entreprise locale de collectage de déchets pour un compostage collectif. Travailler avec des gens qu’elle apprécie, est une nécessité pour elle. Un nouveau défi après celui de monter à plusieurs un lieu d’habitats légers sur la commune de Trignac. Le soutien de la municipalité lui permettra bientôt d’habiter de manière plus solidaire, écologique et créative et je sais que mon fourgon sera le bienvenu.
Nous aimons bavarder ensemble, elle a connu aussi la vie nomade : la liberté et le difficile de la vie en fourgon.
Mais il est l’heure pour chacune de retourner à notre travail et la conversation se finit sur ses mots à elle dont j’aime à me souvenir : Mon petit garçon aime beaucoup les fleurs, c’est rassurant. -
Mon Chéri on the road-26

En fourgon, se mettre à l’abri du soleil et de la chaleur m’a semblé plus difficile que de lutter contre le froid hivernal. Je me suis débrouillée et, heureusement, j’ai choisi l’Auvergne pour ma traversée estivale. Territoire plus généreux en emplacements ombragés.
La rentrée a eu lieu et je me sens plus détendue car il y avait, cet été, bien du monde en camping car, fourgon, van et autres véhicules aménagés. Parfois des rencontres sympathiques, parfois des agacements devant l’insolence de certains à se poser n’importe où, n’importe comment.
Septembre donc et j’arrive à la fin d’un cycle de ma vie nomade. Je pense vivre le fourgon différemment dans quelques mois – les détails pour une prochaine chronique. L’année s’annonce riche en résidences d’écriture, animations et autres rencontres, tant mieux, car j’ai besoin de bosser. Envie de bosser. Et comme tout un chacun, il me faut gagner des sous et, qui s’en étonne encore, les droits d’auteur ne suffisent pas.
Ce matin sur une plage de l’estuaire, la bouleversante lumière du matin a provoqué en moi un sentiment de ravissement – ce n’est pas tous les jours que j’emploie un tel mot. Alors je n’ai rien su dire d’autres que : c’est beau ! et répété merci ! merci ! sans savoir à qui cela s’adressait précisément. J’ai gardé la croyance en un au-delà, certainement des reliquats de mon éducation protestante (des années d’école du dimanche, que j’ai d’ailleurs adorée).
En tout cas, je me suis sentie comblée par le paysage. Ce qui va à l’inverse de mon constat de l’été : cet insatiable besoin de distraction et de sensations fortes qui anime l’être humain. Un coucher de soleil ne suffit plus, il nous faut également un transat, un mojito, un spritz, de la musique d’ambiance, des olives, des chips, une connexion 4 G voire 5G, un filtre pour la photo envoyée sur les réseaux sociaux, dès fois que le soleil ne serait pas à la hauteur de nos désirs d’instagrameurs. La vue d’un sommet ne suffit plus, il faut une tyrolienne, une via ferrata, des sauts vertigineux, de la performance connectée, une descente de torrent en hydrospeed et un spa à l’arrivée. Une bonne partie de la population s’emmerde vite et ne le supporte pas. L’humain a besoin de se distraire de sa propre vie et j’en fais partie, même si j’essaie de prendre de la distance avec ces pratiques avant tout consuméristes.
Sur la plage où la lumière s’impose au sable, je pense à mon besoin de bouger qui a commencé très jeune. Gamine j’explorais les rues d’Amnéville, les rives de la Moselle et aussi les terrains vagues, les usines et le crassier. A dix-sept ans j’ai quitté tout cela en stop avec une amie. La veille du départ, j’avais distribué les affaires auxquelles je tenais à mes copines du quartier. Un peu comme il y a deux ans quand j’ai quitté l’appartement des bords de Saône donnant une bonne partie de mes affaires aux uns et aux unes.
Avec mon amie, nous rêvions du continent indien et sommes restées essentiellement en France.
Lyon sera la ville qui m’aura appris à me poser même si ce fut sur une péniche. Mais ce besoin de mouvement, pas forcément de voyage lointain, ne va jamais me quitter. Je puise de la vitalité autant dans le départ que dans l’arrivée. Pourtant en quittant la maison familiale, j’avais espéré entendre un Reviens qui n’a jamais été à l’ordre du jour de mes parents. Je ne serais sûrement pas rentrée même si je me souviens parfaitement comment, la veille de la rentrée des classes qui ne me comptera pas parmi les élèves, l’angoisse a englué mon sommeil. Encore mineure, pas un sou d’avance, un sac à dos comme tout bagage et, soudainement, j’ai eu envie de rentrer. Envie de redoubler ma terminale, de passer mon bac et de poursuivre des études en fac. Impossible, mes parents avaient jeté le reste de mes affaires et s’apprêtaient à déménager dans une maison sans chambre pour moi. Plus de doutes, il fallait me démerder seule et c’est ce que je ferai. Il en sera de même pour mon plus jeune frère, deux ans plus tard. Avec le recul, même si cela fut difficile, la situation nous aura donné à tous les deux l’énergie de se fabriquer une vie proche de nos désirs ainsi qu’une grande force devant les aléas de la vie. Nous nous sommes dégagé.es, mon frangin et moi, du bourbier familial. Une chance ! -
Mon Chéri on the road – 25

Le soir après la baignade dans le plan d’eau, après le repas toujours bon, après les discussions légères ou plus graves, après les blagues idiotes ou les je me souviens, on va marcher sur la route pour le plaisir des muscles en mouvement, pour voir ce que le soleil couchant propose comme variante de couleurs et de lumière, pour profiter de l’air enfin respirable. Haute-Loire, je me suis invitée chez des ami.es de longue date. Le fourgon me sert de chambre à coucher et le reste de la journée je profite de la fraîcheur de la maison aux volets clos – Nous somme déjà fin août.
Je parviens à écrire Corinne, Nager seule et un autre chantier a débuté : Basse – Bastard – un texte de théâtre où je convoque Violette Leduc, la guitare basse avec la comédienne Anne de Boissy en point de mire. J’ai toujours besoin de mener plusieurs chantiers d’écriture en même temps.
A l’heur où le soleil vous cloue au matelas et à l’ombre, je relis En cas d’amour d’Anne Dufourmantelle, j’y cherche depuis plusieurs années une clé de compréhension de ma vie actuelle sans savoir quoi exactement. Est-ce le titre : En cas d’amour, qui me trouble particulièrement, de ne pas savoir le reformuler ou de me poser la question de mon propre besoin d’aimer et d’être aimée.
En tout cas ce soir, il fait bon et je laisse les deux amies me devancer, je n’ai pas envie de parler et voudrais prendre en photo cet instant : simple, banal et miraculeux.
Mon expérience de la vie nomade est à un tournant. La fatigue tenace de début août, l’entorse au pied droit puis au pied gauche m’interrogent : Poursuivre une seconde année ? Se poser quelque part ? Un ami me fait prendre conscience d’une chose : Les nomades rejoignent souvent les mêmes lieux et, surtout, ne voyagent pas solitaires.
Qu’est-ce que je veux ? et bizarrement me revient cette formule que j’associe à Lacan sans me souvenir pourquoi : Pour qui tu te prends ?
Entre chien et loup, entre chienne et louve, le jour s’achève, la nuit arrive et quelque chose en moi se dénoue.
De retour dans le fourgon, je m’installe pour la nuit et observe le ciel criblé d’étoiles et la fulgurance des étoiles filantes. Je n’ai pas envie de faire de vœu car tout est là pour moi. Présence rassurante des oiseaux nocturnes, de la chienne qui n’aboie jamais, ne gémis jamais malgré les mamelles lourdes d’allaiter ses quatre chiots et la légèreté bienfaisante d’un vent nocturne. Je n’ai pas envie de lire, ni d’écrire. Je suis. Et je sais que ces mots, un jour, je ne pourrais plus les prononcer mais là tout de suite JE est vivante et présente au monde … Oui, je sais que là-bas des guerres, des fuites devant des incendies géants, des corps détenus, mal traités, violés. Je sais. Je sais … mais ce soir, je chantonne une balade du film Rio Bravo, un des rares westerns avec La Prisonnière du désert que j’apprécie, c’est une chanson interprétée par Dean Martin et Ricky Nelson :The sun is sinking in the west
The cattle go down to the stream
The redwing settles in the nest
It’s time for a cowboy to dream
https://www.youtube.com/watch?v=_MXcL1F3OMs -
Mon Chéri on the road – 24

Malgré la bruine et le vent, je suis bien, posée depuis deux jours, vers la roche fileuse qui domine la Creuse. Je pourrais vivre ici, me suis-je dit. Il y a une semaine je quittais Faux-la-Montagne et toute l’équipe de la 18ème édition du festival Folie les mots. Trois jours de théâtre, littérature, musique, ateliers. Gratuité et bénévolat sont le crédo de ce festival. Je pense à d’autres événements auxquels j’ai participé, essentiellement basés sur l’engagement des équipes organisatrices et des équipes artistiques : La Fête de la poésie jeunesse à Tinqueux, Concertina à Dieulefit, Festival des Arpenteurs aux Adrets etc.
Des lieux pour resserrer les boulons de nos convictions politiques, de nos engagements artistiques et associatifs.
Ensuite j’ai passé quelques jours chez un couple de photographes qui retapent une maison sur un terrain de 5 hectares dont un vaste étang. J’ai pu me baigner, nue, traversée par un double sentiment de plaisir et d’inquiétude à être si vulnérable dans l’ombre des imposants chênes, châtaigniers, pins et autres arbres que je ne sais pas nommer. Un texte poétique prend forme depuis quelques jours : Nager, seule.
Le vent agite gracieusement la moustiquaire du fourgon pendant que la sculpture de Saint Guerluchon veille sur moi. De nombreuses rencontres ces derniers jours. D’abord François qui me raconte combien sa jeunesse fut difficile, à ne pas savoir quoi faire de lui, entravé par un lourd bégaiement. Sa vie prend sens suite à une formation d’ambulancier, métier qu’il a adoré. A tel point, qu’un ami de longue date lui fera remarquer : Mais tu ne bégaies plus ! Il ne s’en était pas rendu compte. Sur le camping de Faux, j’avais repéré une jeune femme solitaire, j’ai été la saluer mais se dire semblait compliqué pour elle : oui elle voyage seule, dort sous un abri (elle nomme ainsi sa tente) et aimerait trouver un endroit où s’arrêter plus longuement. Je n’insiste pas. Avant son départ, elle déposera dans ma main deux fleurs de millepertuis. Deux fragiles soleils jaunes.
A Crozant, je bois un café et mange une gaufre à la terrasse de lôtel du lac. Un vieux monsieur s’approche de moi, curieux de savoir si j’écris sur la région – j’étais en train de prendre des notes dans mon carnet – Écrivaine oui, mais pas régionaliste. Puis il me raconte sa vie, né en 1940, il a été placé en nourrice puis dans des familles d’accueil le temps de la guerre et aussi après – la mère doit travailler. Adulte il s’engagera dans la marine, suivra des études en électronique, montera une entreprise assez prospère. Il est également sourcier. Je n’arrive pas à tout suivre mais j’écoute. Puis il me raconte comment, soixante après, il a retrouvé une des maisons où il avait été accueilli. Il ose frapper à la porte et … Sa voix s’étrangle, ses yeux se mouillent. Il reste un long moment sans pouvoir poursuivre. Et enfin : Elle était là devant moi, et elle m’a reconnue de suite. Des larmes encore, je tente quelques mots de réconfort. Il ne m’en dira pas plus, me quitte assez vite et me voilà dépositaire de ce bout d’histoire. Il se nomme Claude, il a quatre-vingt deux ans et me prouve, encore une fois, combien l’amour et la reconnaissance sont nécessaires à nos vies si brèves quand on arrive à l’autre bout. Dans les toilettes de l’hôtel, des larmes me secouent à mon tour. Je pleure sur qui ? Sur quoi ? Je n’en sais rien. Corps bouleversé. Ma solitude mesure toute la nécessité des autres dans nos vies. Aimer. Être aimé et vivre. Je vis.
Le vent agite un peu plus violemment la moustiquaire, la météo annonce des coups de vent. De la pluie. J’enfile un imper, noue un foulard autour de ma gorge. Je vais profiter de la vue une dernière fois. Tout à l’heure je pars en Corrèze. Les deux soleil jaunes sèchent dans un livre – Histoire de ma vie de Georges Sand acheté après la visite de sa maison à Nohant-Vic. Monique Wittig, Louise Michel, Simone de Beauvoir, Laura Vasquez, Déborah Lévy, Violette Leduc, Liliane Giraudon… Elles sont là, avec moi, dans le fourgon. -
Mady

C’est une voix qui m’interpelle de l’autre côté de la route alors que je regarde une très belle bâtisse à l’abandon : Elle n’est pas à vendre. Malheureusement ! Nous échangeons quelques phrases et je traverse la route qui est trop bruyante pour s’entendre correctement. Elle a quatre-vingt ans et c’est de la mort de son mari qu’elle me parle en premier, il y a quarante ans. Le mari camionneur. Puis très vite, elle m’invite à venir voir ses broderies au point de Sarrasin dit aussi point d’Aubusson. Je rentre dans sa maison parfaitement rangée et chargée de souvenirs et d’objets. On voudrait tout regarder de près. Des photos du fils et des petit-enfants sur un meuble du salon.
Installée dans son fauteuil, elle commente chaque broderie essentiellement des marques pages (vendus à la Cité International de la tapisserie) et des carrés de tissus. Parfois elle s’essaie au patchwork. Le point de Sarrasin est exigeant car minutieux et lent. Seulement une dizaine de personnes le maîtriseraient correctement – une association veille d’ailleurs à sa transmission. Mady a toujours vécu à Aubusson, elle a tenu un magasin de dessous féminins : Frou-Frou.
Je prends ses broderies en photo mais elle ne veut pas être sur l’image : J’ai toujours l’air triste. Triste, elle ne l’est pas et parle avec une voix alerte, un brin malicieuse. Malgré les difficultés à marcher, elle m’emmène dans son garage où attendent des trésors en bocaux : confitures à la myrtille, à l’abricot, à la prune et je repars avec un pot de confiture à la groseille qui sera exactement comme j’aime, pas trop sucré, fruité et légèrement acidulé.
Un jour Mady me téléphonera pour me remercier d’avoir parlé d’elle dans ma chronique. Elle va bien et me promet un pot de confiture à la myrtille si je repasse à Aubusson. Son coup de fille donne du sens à cette série de portraits et pas de doute, qu’un jour, je viendrais chercher mon pot de confiture.