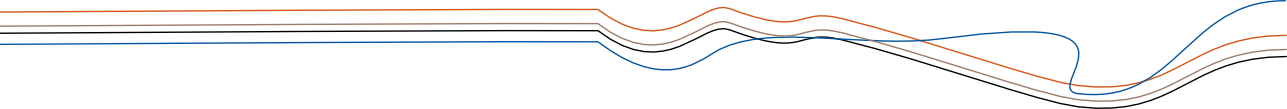Ce matin le réveil fut laborieux même si, pour une fois, j’ai dormi d’une traite. Café du matin pour revivifier les neurones et réfléchir au contenu de cette chronique. Qu’est-ce qui est important à écrire ? Laisser trace de quoi ? Dire ce qui va ? Ce qui ne va pas ? Le trop à dire m’a toujours embarrassée. Je pourrais parler de mon besoin de nager. Hier encore, baignade dans le lac de Vioreau près de Joué-sur-Erdre. D’abord la nuit solitaire sur le pré qui sert de parking – interdit au campement – mais plus personne pour s’en soucier à cette époque de l’année. Le bruit des animaux diurnes bien moins inquiétant que le moteur de la voiture qui vers deux heures du matin a foncé sur le chemin pour repartir aussitôt, phares qui balaient l’obscurité comme dans un mauvais thriller. Heureusement, la nuit, le fourgon de couleur marron est peu visible et les rideaux occultants me permettent de lire en toute tranquillité. Mon unique peur est d’être repérée par un homme ou un groupe d’hommes pour qui une femme seule est une femme qu’on peut emmerder. Je ne fantasme pas, je lis les journaux, j’écoute les histoires de mes amies et j’ai vécu plus d’une fois cette malheureuse expérience. Alors je me fais discrète, c’était d’ailleurs un critère essentiel dans le choix de mon fourgon : pas de couleurs trop voyantes. Au matin, à travers la vitre arrière, enlacée par ma couette, j’ai regardé la brume s’effacer lentement de la surface du lac. Quand le soleil s’est imposé, malgré la fraicheur, j’ai été nager au milieu des hirondelles de rivage dont la proximité a rendu l’instant presque irréel (comme dans une scène du film Nomadland). Je n’ai pas osé me baigner nue – un pêcheur pas très loin. Je pourrais écrire aussi sur ma rencontre avec les cinq femmes de La Horde comme elles se sont baptisées. Femmes qui ont uni leurs forces, après des années de galère, pour vivre (bientôt) dans des Tiny House regroupées sur un terrain mis à disposition par la commune de Trignac. Nous avons parlé de la nécessité des nouveaux habitats, du nomadisme et du bien que cela fait de rire et de raconter des conneries. Nous étions installées sur la terrasse de mon bar nazairien préféré Sous Les Palmiers. Je pourrais raconter une nuit d’insomnie à m’interroger sur cette gênante façon de jeter la vie intime des gens dans l’espace public par le biais des médias et des réseaux sociaux où la moindre réflexion, la moindre phrase sortie de son contexte devient scandale ou scandaleuse, permettant le buzz vite remplacé par un autre buzz. Empêchant souvent une réflexion de fond. Quelque chose se raidit dans notre relation à ceux et celles qui pensent différemment, ceux et celles qui merdent, ceux et celles qui ne sont pas toujours politiquement correct.es. Le droit à la justice relégué en second plan. Jusqu’au vocabulaire qu’il faudrait employer au risque de passer pour une vieille militante féministe dont il faut se méfier (sic). Mon âge devenu subitement suspect. Les mots du prêt-à-penser : wokisme, islamo-gauchiste, hétéronormé, boomer, réac … Il en était déjà ainsi avec la dialectique des étudiants de mai 68 et des syndicalistes qui permettait d’identifier rapidement son appartenance de classe et empêchait le débat de s’ouvrir clairement avec les ouvriers (et encore moins avec les ouvrières). Pour preuve le documentaire – Reprise du travail – où une femme exprime son impossibilité de retourner dans l’usine Wonder et que le discours des syndicalistes CGT bâillonnent (A voir ou revoir ici). Je n’ai pas peur de qui pense différemment de moi. Je n’ai pas peur de changer de manière de penser mais j’ai besoin d’en discuter et non pas de m’enfermer dans un discours. Une nuit à tenter de mettre au clair ma crainte d’un monde sous surveillance qui risque de rendre souterraine toute forme de pensée dites non-acceptable (par qui ?). Ce qui ne peut se dire devient terreau de la frustration et souvent de la violence. Réflexions confuses, j’en conviens, car elles puisent dans un pressentiment plus qu’une réflexion. Pour l’heure, je suis installée dans le camping La Rivière à Segré-en-Anjou-Bleu, cernée par des campings cars qui pourraient contenir quatre fois mon fourgon. Je ne vois jamais les propriétaires qui s’enferment à l’intérieur où derrière des stores tirés bas. Sauf une fois et j’en ai souri un peu en biais : lui assis qui lit l’Équipe et elle qui balaie le tapis de sol autour de sa chaise (je n’invente rien). En tout cas je dois leur sembler bien manouche avec mon linge qui sèche sur les branches d’arbre, mes chansons de Lola Flores en continu et ma porte latérale grande ouverte. Doivent se demander d’où je viens. Et quand on me pose la question, je ne sais pas toujours répondre car si j’ai une adresse administrative à Lyon, le fourgon est mon seul domicile. La réponse qui pourrait convenir, serait : Je viens d’ailleurs. Une certitude, le soir, quand je referme la porte latérale du fourgon, je me sens chez moi. Et j’y suis bien.
Mon Chéri on the road – 5