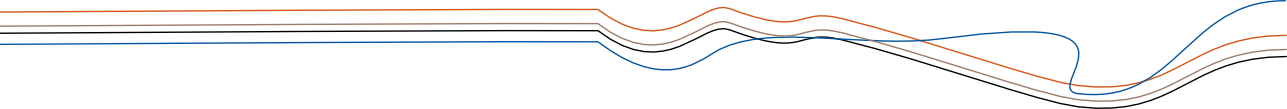Jour de pluie, crachin permanent ou presque. La gestion des entrées et des sorties du fourgon devient primordiale. Le mouillé, le sable, le gravier, la gadoue doivent rester dehors ainsi que les crottes de chien. Un fil tendu à l’arrière de la banquette passager sert d’étendage. Un cintre est prêt à accueillir veste et coupe-vent. Le tapis de sol reçoit les chaussures trempées. La thermos et la bouillotte sont pleines d’eau chaude. Fourgon-refuge. Lumière terne, j’allume une bougie. Aujourd’hui j’ai le cafard. Hier je me baignai à Treac’h Gouder sur l’île d’Houat. L’eau était à 17° mais tout le paysage semblait m’appartenir (j’en parlerai dans une autre chronique). Aujourd’hui je ne parviens pas à écrire, ni à lire, ni à envisager une quelconque activité.Je déteste être dans cet état. Bouge de là, je bougonne… et je m’écoute. Direction Paimboeuf, rive sud de l’estuaire. J’emprunte le majestueux pont sur la Loire que je photographie ensuite de la plage de Saint-Brévin. Je reprends le volant en écoutant, sans y entrer, le dernier album de Björk. Paimboeuf. C’est d’abord un alignement de maisons, collées-serrées, qui accompagnent la courbure du fleuve. Certaines façades osent des couleurs vives ou d’étonnants collages dont un fabriqué avec des centaines de circuits intégrés numériques. De l’autre côté de la rive s’impose les cheminées, les cuves et les ateliers de la raffinerie de Donges. Ici est un lieu comme j’aime parcourir, de ceux qui racontent la vie industrielle. La vie laborieuse. On ne peut comprendre un territoire si on se contente que du beau, du touristiquement correct. Je marche d’abord le long du fleuve, m’attarde devant le Café de l’Avenir qui fait preuve d’un bel optimisme avec sa façade recouverte de gazon synthétique. Des panneaux indiquent le centre-ville que je ne trouve jamais. La boulangère me donne une explication : il n’y en a pas ou du moins il n’y en a plus. Je mitraille les portails, les maisons plus ou moins gracieuses, les fenêtres murées. Puis il pleut à nouveau. Je rejoins Mon Chéri. Tape soigneusement les semelles de mes chaussures avant de monter, sèche mes cheveux, me prépare un café que j’accompagne d’une tranche de cake aux fruits. Les pieds calés contre le frigo, je finis l’article sur ces Russes qui refusent de se faire tuer sur le front ukrainien. Je les comprends follement. A quoi bon mourir pour des intérêts financiers et l’obsession d’un président ivre de pouvoir. Venir gonfler la liste des héros soit-disant morts pour la patrie est une récompense bien dérisoire. Les monuments historiques participent à fabriquer la fiction des combattants héroïques. Le patriotisme est l’arme des puissants pour convaincre le peuple de se sacrifier à sa place. Et celui qui en doute sera, de toute façon, passé par les armes d’un tribunal militaire. Sur le carnet de notes, ce matin, j’ai écris la phrase du poète boxeur Arthur Cravan disparu en 1918 et qui accompagne d’un sourire en demi-teinte ma lecture de ce soir : La vie est sans solution.
Mon Chéri on the road – 6